Mois de l'imaginaire
L’imaginaire en adaptation
Publié le 15/10/2018 à 00:07
-  18 min -
Modifié le 16/10/2018
par
Yôzô-san
18 min -
Modifié le 16/10/2018
par
Yôzô-san
Pour la deuxième année consécutive, le mois d’octobre devient celui où l’imaginaire prend le pouvoir. Partout en France, dans les bibliothèques, les librairies, les festivals, les initiatives se multiplient afin de faire connaître et valoriser cette littérature qui véhicule encore une image très négative auprès du grand public et des prescripteurs. Il est cependant un lieu où l’imaginaire a depuis longtemps droit de cité : l’écran (petit et grand) comme en témoigne le succès foudroyant, à la fois populaire et critique, de la série Game of Thrones.
Une petite histoire de l’adaptation
Avec le boom des séries télévisées que nous connaissons ces dernières années, force est de constater que pour bon nombre d’entre elles il ne s’agit pas de scénarii originaux mais d’adaptations de romans ou de nouvelles d’imaginaire. Cependant, si ce phénomène a très nettement gagné en ampleur, il n’a rien de nouveau.
Un genre né avec le cinéma
Et pour cause, puisque c’est au tout début du XXe siècle, en 1901, que la première adaptation d’un roman d’imaginaire a été réalisée. Le film, tourné par Ferdinand Zecca et produit par Charles Pathé, prendra le titre du roman dont il est tiré : Les enfants du capitaine Grant. Il sera rapidement suivi de deux autres courts métrages eux aussi adaptés de Jules Verne avec Le voyage dans la lune de Méliès en 1902, librement inspiré du roman De la terre à la lune, puis 20000 lieues sous les mers de Wallace McCutcheon en 1905. On dénombre aujourd’hui environ 300 adaptations sur grand écran des écrits de Jules Verne, ce qui en fait l’auteur d’imaginaire qui a le plus inspiré le cinéma, devant même H.G. Wells pour qui l’on compte tout de même plus d’une cinquantaine de films tirés de son œuvre.
Lorsqu’on examine une partie de la production cinématographique de science-fiction et de fantastique des débuts du 7e art, on réalise que celle-ci fait la part belle aux adaptations :
- Le voyage dans la lune de Méliès adapté de Jules Verne (1902)
- Dr Jekyll and Mr Hyde de John S. Robertson adapté de Robert Louis Stevenson (1908)
- Frankenstein de J. Searle Dawley adapté de Mary Shelley (1910)
- The First men in the moon de Bruce Gordon et J.L.V. Leigh adapté d’H.G. Wells (1919)
- 20000 lieues sous les mers de Stuart Paton, adapté de Jules Verne (1920)
- Aelita : reine de Mars de Yakov Protazanov adapté d’Aleksey Tolstoy (1924)
- Metropolis de Fritz Lang adapté de Thea von Harbou (1927)
Si aujourd’hui le cinéma de science-fiction est parfois, au même titre que la littérature du même genre, considéré par certains comme un « mauvais genre » et méprisé par la critique, ce n’est visiblement pas le cas à l’époque. De fait, en se penchant sur ces premières productions adaptées des grands textes de la littérature de l’imaginaire, les réalisateurs semblent animés du même désir que les auteurs de ces textes : s’interroger sur la nature humaine ou prévenir des dangers qui guettent l’humanité du point de vue politique et social, objectif qu’il n’est alors pas aisé d’atteindre car le cinéma ne deviendra parlant qu’à compter d’octobre 1927 avec la sortie du Chanteur de jazz. Ainsi, quand un réalisateur tel que John S. Robertson adapte Dr Jekyll et Mr Hyde en 1908, c’est entre autres parce que le recours au fantastique est sans doute l’un des outils qui permet le mieux de mettre en scène un homme prisonnier de ses pulsions dans un cinéma qui n’a pas encore tous les procédés narratifs qu’on lui connait maintenant.
L’âge d’or Universal Studio
 Faisons un petit saut dans le temps. À partir des années 30, une importante vague d’adaptations va inonder de grand écran avec les productions des studios Universal qui vont marquer à jamais le cinéma.
Faisons un petit saut dans le temps. À partir des années 30, une importante vague d’adaptations va inonder de grand écran avec les productions des studios Universal qui vont marquer à jamais le cinéma.
En 1931, les Studio Universal s’attaquent à l’un des plus grands classiques de la littérature fantastique : Dracula. Incarné par l’acteur Transylvanien Béla Lugosi et porté sur grand écran par Tod Browning, cette adaptation connaît un succès retentissant.
La même année, c’est au tour de Frankenstein d’être adapté. Cette fois-ci les studios Universal confieront la réalisation à James Whale et le rôle de la créature à Boris Karloff.
Avec ces deux films, ce ne sont pas seulement deux acteurs qui sont révélés au grand public, mais bien deux icônes qui sont nées ! Par leurs interprétations, Karloff et Lugosi deviennent dans l’imaginaire collectif les visages de la créature de Frankenstein et du comte Dracula. Ils éclipsent complètement les autres personnages, à tel point que la créature du docteur Frankenstein finira même par voler son nom à son créateur.
Les suites : un tournant en matière d’adaptation
 Suite au triomphe rencontré par ces films, les studios Universal vont poursuivre sur cette lancée et adapter deux autres romans fantastico-horrifiques, L’homme invisible de Wells et Le fantôme de l’opéra de Gaston Leroux. Parallèlement, ces studios vont également chercher à capitaliser sur les succès des deux premiers films et vont pour cela créer un nouveau type d’adaptation : les suites. En 1935, Boris Karloff reprend du service dans La fiancée de Frankenstein, film qui pose un nouveau jalon dans le travail d’adaptation puisque si l’on retrouve les personnages originaux de Mary Shelley, ceux-ci évoluent dans une histoire complètement inédite. Si pour La fiancée de Frankenstein, on tente encore de replacer le film sous le patronage de Mary Shelley en lui attribuant le rôle de la narratrice qui, à la demande de Lord Byron, va conter les suites des aventures de la créature, l’attachement aux auteurs et à leurs œuvres va rapidement s’étioler. En effet, au fur et à mesure que ce processus de suite sera réutilisé pour les films de la licence Universal Monsters, on va progressivement en arriver à des productions cinématographiques n’ayant plus aucun lien scénaristique avec les textes qui les ont inspirés, si ce n’est les noms attribués à certains personnages ; au point d’aboutir à des films qui frisent de plus en plus l’absurde dans lesquels Frankenstein et Dracula croisent le Loup-garou comme c’est le cas dans La maison de Frankenstein (1945) ou à un film comme L’agent invisible contre la Gestapo (1942).
Suite au triomphe rencontré par ces films, les studios Universal vont poursuivre sur cette lancée et adapter deux autres romans fantastico-horrifiques, L’homme invisible de Wells et Le fantôme de l’opéra de Gaston Leroux. Parallèlement, ces studios vont également chercher à capitaliser sur les succès des deux premiers films et vont pour cela créer un nouveau type d’adaptation : les suites. En 1935, Boris Karloff reprend du service dans La fiancée de Frankenstein, film qui pose un nouveau jalon dans le travail d’adaptation puisque si l’on retrouve les personnages originaux de Mary Shelley, ceux-ci évoluent dans une histoire complètement inédite. Si pour La fiancée de Frankenstein, on tente encore de replacer le film sous le patronage de Mary Shelley en lui attribuant le rôle de la narratrice qui, à la demande de Lord Byron, va conter les suites des aventures de la créature, l’attachement aux auteurs et à leurs œuvres va rapidement s’étioler. En effet, au fur et à mesure que ce processus de suite sera réutilisé pour les films de la licence Universal Monsters, on va progressivement en arriver à des productions cinématographiques n’ayant plus aucun lien scénaristique avec les textes qui les ont inspirés, si ce n’est les noms attribués à certains personnages ; au point d’aboutir à des films qui frisent de plus en plus l’absurde dans lesquels Frankenstein et Dracula croisent le Loup-garou comme c’est le cas dans La maison de Frankenstein (1945) ou à un film comme L’agent invisible contre la Gestapo (1942).
Une société de production, chère à bon nombre de cinéphiles, connaîtra un parcours assez similaire : la Hammer. Avec leur série de films tirés du Dracula de Bram Stoker, ce sont deux nouvelles têtes d’affiche qui vont émerger, Christopher Lee et Peter Cushing. Cette nouvelle vague d’adaptations ancrées dans une esthétique que l’on pourrait qualifier de gothique victorienne, va donner la part belle à deux caractéristiques du comte bien présente chez Bram Stoker mais jusque-là absentes des adaptations : la figure du vampire sanguinaire avec ses canines particulièrement pointues et des effusions d’hémoglobine, et la figure érotique de celui-ci.
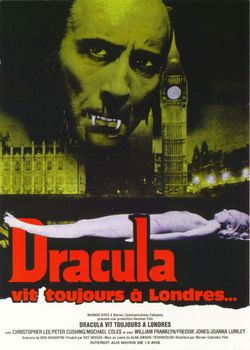 Cependant, comme les studios Universal avant eux, au fil des adaptations le lien va se faire de plus en plus ténu avec le mythe créé par Bram Stoker, au point d’aboutir à des productions particulièrement kitch comme Dracula vit toujours à Londres (1973) dans lequel Dracula s’associe à un groupe de capitalistes londoniens pour renverser le gouvernement. Au point même que Christopher Lee finira par ne plus vouloir reprendre le rôle, estimant les scénarii indignes de lui et carrément injurieux à l’encontre de Bram Stoker.
Cependant, comme les studios Universal avant eux, au fil des adaptations le lien va se faire de plus en plus ténu avec le mythe créé par Bram Stoker, au point d’aboutir à des productions particulièrement kitch comme Dracula vit toujours à Londres (1973) dans lequel Dracula s’associe à un groupe de capitalistes londoniens pour renverser le gouvernement. Au point même que Christopher Lee finira par ne plus vouloir reprendre le rôle, estimant les scénarii indignes de lui et carrément injurieux à l’encontre de Bram Stoker.
Parce qu’il n’y a pas qu’au cinéma qu’on a eu droit à des adaptations décalées, voici deux titres contemporains de certaines des fameuses suites produites par les studios Universal :
The Mummy’s Ball par The Verdicts
The Monster Mash par Bobby Pickett
L’OVNI Corman
 Comment aborder l’adaptation cinématographique sans parler du roi de la série B, Roger Corman ? Au début des années 60, Corman se lance dans une série de sept films librement adaptés des nouvelles d’Edgar Allan Poe, et qui comme l’ensemble de sa production se feront sur le même modèle. Il s’agit de films à petit budget, tournés ultra rapidement (le tournage dure entre cinq jours et trois semaines en moyenne, bien loin du tournage du deuxième volume du Seigneur des anneaux par Peter Jackson qui s’est étalé sur dix mois), un casting très restreint reprenant souvent les mêmes acteurs, et des décors sommaires. Avec ces restrictions pourtant importante, Corman nous offre un cycle de films devenus cultes, parvenant par le travail d’interprétation parfois un tantinet exagéré des acteurs, l’usage de la fumée et du Cinémascope, à rendre un vibrant hommage à l’œuvre de Poe. Même si le réalisateur se permet quelques entorses aux textes originaux, on y retrouve toutes les composantes de la littérature poeienne : le poids du passé, la malédiction trans-générationnelle, la mort et l’enfermement. À cet égard, son adaptation du Corbeau, sort du lot puisque d’un poème gothique résolument sombre il a tiré une sorte de vaudeville fantastique totalement délirant atteignant les sommets du kitch avec un combat de sorciers, comme quoi, avec le processus d’adaptation, tout peut arriver.
Comment aborder l’adaptation cinématographique sans parler du roi de la série B, Roger Corman ? Au début des années 60, Corman se lance dans une série de sept films librement adaptés des nouvelles d’Edgar Allan Poe, et qui comme l’ensemble de sa production se feront sur le même modèle. Il s’agit de films à petit budget, tournés ultra rapidement (le tournage dure entre cinq jours et trois semaines en moyenne, bien loin du tournage du deuxième volume du Seigneur des anneaux par Peter Jackson qui s’est étalé sur dix mois), un casting très restreint reprenant souvent les mêmes acteurs, et des décors sommaires. Avec ces restrictions pourtant importante, Corman nous offre un cycle de films devenus cultes, parvenant par le travail d’interprétation parfois un tantinet exagéré des acteurs, l’usage de la fumée et du Cinémascope, à rendre un vibrant hommage à l’œuvre de Poe. Même si le réalisateur se permet quelques entorses aux textes originaux, on y retrouve toutes les composantes de la littérature poeienne : le poids du passé, la malédiction trans-générationnelle, la mort et l’enfermement. À cet égard, son adaptation du Corbeau, sort du lot puisque d’un poème gothique résolument sombre il a tiré une sorte de vaudeville fantastique totalement délirant atteignant les sommets du kitch avec un combat de sorciers, comme quoi, avec le processus d’adaptation, tout peut arriver.
Le cycle Edgar Poe de Roger Corman :
- La Chute de la maison Usher (1960 – tiré de la nouvelle éponyme)
- La chambre des tortures (1961 – adapté de la nouvelle Le Puits et le pendule)
- L’enterré vivant (1962 – issu de L’enterrement prématuré)
- L’empire de la terreur (1962 – tiré des nouvelles La vérité sur le cas de M. Valdemar, Morella et Le chat noir)
- Le corbeau (1963 – librement inspiré du poème du même titre)
- La malédiction d’Arkham (1963 – Corman qui voulait alors faire une pause dans les adaptations de Poe réalise ce film qui prend ses sources dans le roman L’affaire Charles Dexter Ward de Lovecraft. Mais les studios, pour capitaliser sur les succès commerciaux des précédents films vont, contre l’avis du réalisateur, donner à cette œuvre un titre tiré d’un poème de Poe : Le Palais hanté, afin de la vendre comme une nouvelle adaptation de Poe par Corman)
- Le masque de la mort rouge (1964 – adapté de la nouvelle éponyme)
- La tombe de Ligeia (1964 – tiré de Ligeia)

And now ladies and gentlemen… l’essor des séries
Auparavant considérée comme un support d’expression filmique de seconde zone, la série télé a récemment acquis ses lettres de noblesse. Le petit écran devenant désormais un support d’expression presque tout aussi noble que le grand écran, attirant aussi bien les grands réalisateurs (David Lynch, Jane Campion, David Fincher, Martin Scorsese ou Steven Soderbergh pour n’en citer que quelques-uns) que les acteurs de renom (Kirsten Dunst, Nicole Kidman, Ewan McGregor, Jane Fonda, Matthew McConaughey, etc …).
Si la série finit par séduire tout ce beau monde c’est parce qu’elle permet de travailler sur une temporalité différente de celle du film. Si l’on appelle un film un long métrage, alors une série peut être vue comme un très long métrage, ainsi que David Lynch a pu le montrer avec la dernière saison de Twin Peaks. C’est tout simplement la possibilité de traiter d’un sujet in extenso, sans avoir à recourir aux ellipses, ou de suivre un personnage dans son intimité et dans son intégralité que nous offre ce format, tout en touchant le plus grand nombre possible de spectateurs.
De fait, la série semble particulièrement propice à l’adaptation car elle permet de raconter une histoire dans le détail, sans rien omettre, voir même pousser la réflexion ou l’histoire plus loin qu’elle ne l’était dans le roman ou dans la nouvelle dont elle est issue, ce qu’un film ne peut permettre à moins de recourir à la série cinématographique comme l’a fait Peter Jackson avec son adaptation du Hobbit. Des avantages tels que l’on voit de plus en plus d’adaptations en tous genres débarquer sur le petit écran, et qui nous laissent penser que ce n’est pas près de s’arrêter.
Petit panorama de l’adaptation télévisuelle 2017-2018
Altered Carbon
 Au même moment où Blade Runner 2048 est arrivé au cinéma, souhaitant à leur tour proposer une adaptation d’un roman d’anticipation noire, les studios Netflix ont opté pour Altered Carbon de Richard Morgan. L’action se situe dans un futur dans lequel la mort n’est plus une fatalité puisque l’on peut désormais uploader son esprit à l’intérieur de puces et ainsi transférer sa conscience de corps en corps.
Au même moment où Blade Runner 2048 est arrivé au cinéma, souhaitant à leur tour proposer une adaptation d’un roman d’anticipation noire, les studios Netflix ont opté pour Altered Carbon de Richard Morgan. L’action se situe dans un futur dans lequel la mort n’est plus une fatalité puisque l’on peut désormais uploader son esprit à l’intérieur de puces et ainsi transférer sa conscience de corps en corps.
Adapter en 2018 un roman d’anticipation paru en 2002 est un pari risqué car il y a fort à parier que les réflexions sur un sujet comme le transhumanisme auront bien avancé. Du coup, de ce point de vue, alors que Blade Runner 2049 nous sert une véritable mise en abîme avec des répliquants qui nous poussent à nous interroger sur notre humanité, on se trouve quelque peu déçu par le manque de réflexion qui se fait au profit de scènes d’action musclées. Pourtant certaines pistes étaient lancées dans le roman avec notamment l’apparition de mouvements religieux opposés au transfert d’âme d’une enveloppe corporelle à une autre. La série Altered Carbon nous propose donc une adaptation très libre du roman puisque les changements opérés sont très nombreux et ne confinent pas aux détails : qu’il s’agisse des liens des personnages entre eux (Raelene n’est pas la sœur de Takeshi dans le roman mais juste un boss de la mafia), des organisations militaires (les Envoys ne sont pas des rebelles mais un groupe d’opérations armées du gouvernement), d’Ortega qui est bien loin d’être un personnage majeur dans l’histoire, ou d’un des principaux bad guy de la série — le Ghostwalker — qui n’existe tout simplement pas dans le livre. On ne peut que déplorer le fait que tant qu’à altérer l’ensemble de l’œuvre originale les scénaristes n’aient pas essayé d’en faire quelque chose de plus profond, se contentant ici de dissoudre les interrogations des personnages à grands coups de baston ou de monologues caricaturaux. Dommage.
American Gods
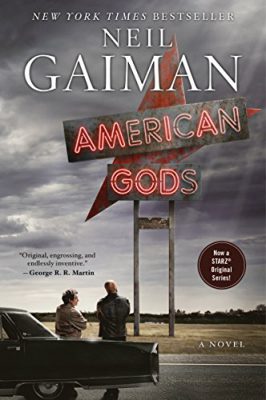 Quand Shadow Moon est libéré de prison, il apprend qu’il a perdu son épouse et son meilleur ami dans un accident de la route. Dans l’avion qui l’emmène jusqu’à leur dernière demeure, Shadow Moon fait la connaissance de l’énigmatique Wednesday qui semble en savoir beaucoup sur lui. L’homme lui propose un job de garde du corps, en lui promettant qu’en l’accompagnant dans son périple il apprendra à se connaître et que sa vision du monde en sera changée. Avec cette adaptation du roman culte de Neil Gaiman, nous voici partis pour un road trip endiablé à travers les USA ; suivant les pérégrinations de Wednesday, qui n’est autre qu’Odin, bien décidé à déclencher une guerre entre les divinités du monde actuel que sont les médias, internet, ou la globalisation et de plus anciennes divinités tombées en désuétude.
Quand Shadow Moon est libéré de prison, il apprend qu’il a perdu son épouse et son meilleur ami dans un accident de la route. Dans l’avion qui l’emmène jusqu’à leur dernière demeure, Shadow Moon fait la connaissance de l’énigmatique Wednesday qui semble en savoir beaucoup sur lui. L’homme lui propose un job de garde du corps, en lui promettant qu’en l’accompagnant dans son périple il apprendra à se connaître et que sa vision du monde en sera changée. Avec cette adaptation du roman culte de Neil Gaiman, nous voici partis pour un road trip endiablé à travers les USA ; suivant les pérégrinations de Wednesday, qui n’est autre qu’Odin, bien décidé à déclencher une guerre entre les divinités du monde actuel que sont les médias, internet, ou la globalisation et de plus anciennes divinités tombées en désuétude.
Bryan Fuller, à qui nous devions déjà l’adaptation pour le petit écran de la saga Hannibal, livre ici une adaptation somme toute assez fidèle du roman de Neil Gaiman, mettant un point d’honneur à retranscrire l’atmosphère sombre des bas-fonds américains et la déliquescence d’une société qui a oublié ses racines, tout en se permettant des petits ajouts ici et là qui sont complètement raccords avec le ton et le propos du roman comme le background de la femme de Shadow Moon ou même le personnage de Vulcain qui, s’il n’est pas dans le livre est tout de même issu d’une anecdote personnelle de l’auteur. La version télévisuelle d’American gods est une belle réussite avec non seulement des acteurs qui sont à la hauteur des personnages qu’ils incarnent et un travail photographique admirable qui contribue à mettre en valeur les différentes facettes de la société américaine et à conférer une caractérisation supplémentaire à chaque divinité croisée. Vivement la saison 2 !
Castle Rock
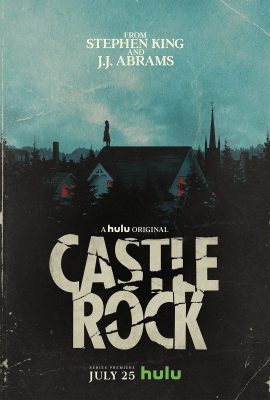 Après Under the dome, 22/11/63 ou Mr Mercedes, Stephen King nous revient sur petit écran avec une nouvelle série inspirée de son œuvre. L’action se déroule dans la ville de Castle Rock au sein de laquelle semblent converger tout un ensemble de trames amorcées dans les romans de King. Ainsi, la ville agit comme une sorte de carrefour du fantastique et de la noirceur humaine. Dans la première saison, on suit le retour d’Henry Deaver à Castle Rock après la découverte d’un jeune homme illégalement détenu au sein de la prison de Shawshank. Ce retour le force à se confronter à un passé qu’il a tout fait pour oublier et à s’interroger sur les certitudes qu’il avait jusque-là concernant l’histoire lourdement émaillée de tragédies de cette bourgade.
Après Under the dome, 22/11/63 ou Mr Mercedes, Stephen King nous revient sur petit écran avec une nouvelle série inspirée de son œuvre. L’action se déroule dans la ville de Castle Rock au sein de laquelle semblent converger tout un ensemble de trames amorcées dans les romans de King. Ainsi, la ville agit comme une sorte de carrefour du fantastique et de la noirceur humaine. Dans la première saison, on suit le retour d’Henry Deaver à Castle Rock après la découverte d’un jeune homme illégalement détenu au sein de la prison de Shawshank. Ce retour le force à se confronter à un passé qu’il a tout fait pour oublier et à s’interroger sur les certitudes qu’il avait jusque-là concernant l’histoire lourdement émaillée de tragédies de cette bourgade.
Si la série offre aux afficionados un véritable fan service avec un univers truffé de clins d’œil aux textes du romancier, et des acteurs connus pour avoir campé des personnages emblématiques de l’œuvre de King comme Sissy Spacek ou Bill Skarsgård, on peut en revanche déplorer un problème de rythme qui donne l’impression que l’histoire fait du sur place. Dommage quand on pense au superbe travail de réalisation qui a été déployé pour le pilote.
On peut cependant s’interroger sur le fait que cette série puisse réellement être qualifiée d’adaptation car, une fois n’est pas coutume, c’est King himself qui est aux commandes du projet, avec J.J. Abrams à ses côtés — ce qui n’est pas si étonnant quand on sait combien King a pu haïr certaines des adaptations qui ont été faites de ses romans. On se retrouve donc avec un objet protéiforme, comme dans le cas des « suites » d’Universal ou de la Hammer : à la fois adaptation car faisant constamment référence à des ouvrages préexistants, et œuvre originale puisque l’histoire qui nous est ici contée est complètement nouvelle. Du coup, on peut se demander si on est vraiment face à une adaptation, ou plutôt face à un auteur qui a simplement décidé de changer de support pour raconter des histoires.
Fahrenheit 451
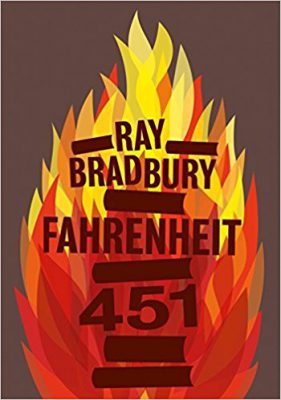 Ouvrage sur les livres, le roman de Ray Bradbury constitue un paradoxe quand on veut l’adapter sur écran. Il n’y a eu pour l’instant que deux tentatives, l’une par François Truffaut en 1966 dans une production britannique et l’autre, plus récente pour la chaine américaine HBO en 2018 par Ramin Bahrani. Même si le film de 66 ne fait pas partie des œuvres les plus marquantes de Truffaut, il s’avère être une transcription plus fidèle du roman que celle d’HBO, même si cette dernière tient compte des nouveaux usages de l’écrit et modernise certains aspects.
Ouvrage sur les livres, le roman de Ray Bradbury constitue un paradoxe quand on veut l’adapter sur écran. Il n’y a eu pour l’instant que deux tentatives, l’une par François Truffaut en 1966 dans une production britannique et l’autre, plus récente pour la chaine américaine HBO en 2018 par Ramin Bahrani. Même si le film de 66 ne fait pas partie des œuvres les plus marquantes de Truffaut, il s’avère être une transcription plus fidèle du roman que celle d’HBO, même si cette dernière tient compte des nouveaux usages de l’écrit et modernise certains aspects.
Depuis les 400 coups, Truffaut veut faire un film centré sur les livres, mais quand on lui propose d’adapter le roman de Bradbury, il rechigne, avouant détester la science-fiction, jusqu’à ce qu’on lui parle vraiment de ce monde où l’on brûle les livres. Conscient qu’il ne peut pas trouver le financement en France, il part pour les studios de Pinewood, près de Londres, les seuls disposant des équipes et du matériel technique pour le feu. Truffaut passe beaucoup de temps sur les scènes montrant les livres, pour les rendre vivants avant de les brûler. Il se rend compte d’ailleurs qu’il est très difficile de faire brûler un livre, et s’assure qu’on puisse lire certaines lignes pour identifier les romans, comme les Frères Karamazov. Il le dit lui-même, certains livres se sont révélés plus photogéniques que d’autres, meilleurs acteurs que d’autres dans leur capacité à créer une émotion en brûlant. D’ailleurs, à ce sujet, Truffaut aura plus de tensions avec son acteur principal, Oskar Werner, qui se pense comme un héros et veut imposer ses idées et refuse même d’assurer certaines scènes avec les lance-flammes. Le film de 1966 a peu d’effets spéciaux et pratiquement pas de scènes de science-fiction à part celle d’hommes-volants recherchant Montag, Truffaut a préféré se concentrer sur les aspects oniriques, créer un rêve dans ce monde cauchemardesque.
Il en résulte un film très fidèle dans l’esprit au livre. Par souci de cohérence, il n’y a pas de générique écrit, les différents noms sont cités oralement à la fin, ce qui accentue les aspects les plus étranges et montre l’aspect radical d’un monde sans texte. Si la fin n’est pas aussi apocalyptique que dans le livre, elle offre un optimisme salutaire, comme une renaissance de la civilisation grâce au texte.
 Le principal mérite de l’adaptation de 2018, c’est d’avoir modernisé l’approche en étendant l’écrit au numérique, en le dissociant du support papier. Les écrans sont partout, les caméras aussi et toute information peut être likée, réduisant l’action des citoyens à des émoticônes puisqu’ils ne peuvent pas exprimer de pensée construite par de l’écrit. Contrairement au film de 1966 ou au livre, il y a même une explication cohérente de l’interdiction de l’écrit, par sa capacité à nuire, à dissocier les gens et l’on peut y voir là une critique des réseaux sociaux qui peuvent littéralement s’enflammer par des polémiques incessantes. Cependant là où Truffaut avait cherché à limiter les scènes spectaculaires, le film de Ramin Bahrani les multiplie et en rajoute au point d’étouffer les concepts les plus émouvants. L’idée des hommes-livres, idée finale autant chez Bradbury que chez Truffaut, devient un élément annexe pour un autre artifice scénaristique. Montag n’est qu’un instrument et l’on perd cette idée que chaque individu peut être porteur d’une parcelle de culture, au profit d’une sorte de superhéros de la civilisation, un enfant appelé Omnis. C’est au final une vision bien moins égalitaire et ouverte que celle de Truffaut.
Le principal mérite de l’adaptation de 2018, c’est d’avoir modernisé l’approche en étendant l’écrit au numérique, en le dissociant du support papier. Les écrans sont partout, les caméras aussi et toute information peut être likée, réduisant l’action des citoyens à des émoticônes puisqu’ils ne peuvent pas exprimer de pensée construite par de l’écrit. Contrairement au film de 1966 ou au livre, il y a même une explication cohérente de l’interdiction de l’écrit, par sa capacité à nuire, à dissocier les gens et l’on peut y voir là une critique des réseaux sociaux qui peuvent littéralement s’enflammer par des polémiques incessantes. Cependant là où Truffaut avait cherché à limiter les scènes spectaculaires, le film de Ramin Bahrani les multiplie et en rajoute au point d’étouffer les concepts les plus émouvants. L’idée des hommes-livres, idée finale autant chez Bradbury que chez Truffaut, devient un élément annexe pour un autre artifice scénaristique. Montag n’est qu’un instrument et l’on perd cette idée que chaque individu peut être porteur d’une parcelle de culture, au profit d’une sorte de superhéros de la civilisation, un enfant appelé Omnis. C’est au final une vision bien moins égalitaire et ouverte que celle de Truffaut.
Cette adaptation bénéficie des moyens d’adaptation moderne, avec un beau travail de l’image et des lumières, mais c’est aussi la moins fidèle au roman de Ray Bradbury, justement parce qu’elle ne fait pas des livres les héros et reste engoncée dans le carcan du schéma héroïque classique hollywoodien. Pourtant, la tentative de moderniser le propos était louable et intégrer les réseaux sociaux dans la problématique ne devait pas être évitée, mais il aurait sans doute été préférable de conserver l’aspect poétique des œuvres de Bradbury, sa quintessence et sa particularité parmi les auteurs de science-fiction.
Le Maître du Haut Château
 Adapter Le Maître du haut-château de Phillip K. Dick, œuvre atypique s’il en est, est un projet particulièrement audacieux tant ce roman n’est a priori pas propice à une transcription cinématographique ou télévisuelle. En effet dans ce livre paru en 1962, plus qu’une histoire organisée autour d’une véritable intrigue, c’est un portrait de ce qu’aurait été le monde si les forces de l’Axe avaient fait usage de la bombe et remporté la seconde guerre mondiale. De fait le roman offre à la fois beaucoup de matière pour une adaptation car il dépeint avec force détails l’impact du totalitarisme sur une société qui y est soumise depuis plus de quinze ans, s’interrogeant sur l’humanité/inhumanité quotidienne et sur notre rapport au réel, et très peu car il s’agit là d’un texte avec très peu de dialogues et des trames narratives foisonnantes mais sans liens entre elles. Du coup, le duo Ridley Scott et Frank Spotnitz à la tête du projet a opté pour une approche elle aussi atypique, mais pour le moins intéressante : en se basant sur les réflexions portées par le roman de Phillip K. Dick et sur les personnages qui s’en dégagent, développer une fiction qui soit à la fois respectueuse de la richesse de l’univers créé par l’auteur et en adéquation avec le format télévisuel.
Adapter Le Maître du haut-château de Phillip K. Dick, œuvre atypique s’il en est, est un projet particulièrement audacieux tant ce roman n’est a priori pas propice à une transcription cinématographique ou télévisuelle. En effet dans ce livre paru en 1962, plus qu’une histoire organisée autour d’une véritable intrigue, c’est un portrait de ce qu’aurait été le monde si les forces de l’Axe avaient fait usage de la bombe et remporté la seconde guerre mondiale. De fait le roman offre à la fois beaucoup de matière pour une adaptation car il dépeint avec force détails l’impact du totalitarisme sur une société qui y est soumise depuis plus de quinze ans, s’interrogeant sur l’humanité/inhumanité quotidienne et sur notre rapport au réel, et très peu car il s’agit là d’un texte avec très peu de dialogues et des trames narratives foisonnantes mais sans liens entre elles. Du coup, le duo Ridley Scott et Frank Spotnitz à la tête du projet a opté pour une approche elle aussi atypique, mais pour le moins intéressante : en se basant sur les réflexions portées par le roman de Phillip K. Dick et sur les personnages qui s’en dégagent, développer une fiction qui soit à la fois respectueuse de la richesse de l’univers créé par l’auteur et en adéquation avec le format télévisuel.
Du coup, cette série divisera l’opinion. Pour certains cette série sera sans nul doute perçue comme un outrage fait au roman ; faisant de l’uchronie originale une histoire somme toute assez différente avec de nouveaux arcs narratifs centrés autour de personnages absents de l’œuvre originale. Pour d’autres, il s’agira d’une série proposant une immersion dans l’univers de Phillip K. Dick, rendant hommage à sa minutie par une abondance de détails historiques et une attention particulière apportée aux décors, et illustrant ses réflexions sur la morale, la dictature ou le pouvoir à travers des personnages complexes.
Sorti de ce contexte d’adaptation, Le Maître du haut-château est une série bien réalisée, avec un joli travail photographique et une histoire qui prend son temps pour évoluer, nous permettant par là de rendre cet univers crédible et de sentir tout le poids de l’oppression. Un série pour ceux qui aiment prendre leur temps, s’appesantir sur la condition humaine et pour qui les scènes d’action sont optionnelles.
La Servante écarlate
 Il était difficile d’adapter le roman de Margaret Atwood, tellement il était centré sur l’huis-clos et l’enfermement de l’héroïne dans ce monde oppressant. Il fallait aussi façonner et enrichir une galerie de personnages qui n’étaient parfois que des silhouettes ou des bourreaux. La série télévisée a réussi en créant d’abord une atmosphère visuelle, avec des tons d’automne, une froideur dans les couleurs à l’exception du rouge des servantes. Elles en deviennent le point focal, la seule preuve de vie dans un univers gris et terne.
Il était difficile d’adapter le roman de Margaret Atwood, tellement il était centré sur l’huis-clos et l’enfermement de l’héroïne dans ce monde oppressant. Il fallait aussi façonner et enrichir une galerie de personnages qui n’étaient parfois que des silhouettes ou des bourreaux. La série télévisée a réussi en créant d’abord une atmosphère visuelle, avec des tons d’automne, une froideur dans les couleurs à l’exception du rouge des servantes. Elles en deviennent le point focal, la seule preuve de vie dans un univers gris et terne.
Pour rendre l’acuité et la pugnacité du personnage central, Defred, la série a assumé la voix intérieure, avec son côté littéraire. Toute la révolte s’entend dans cette voix, alors que le personnage se retrouve dans une société où on la bâillonne, où on la fait taire. Elizabeth Moss n’a souvent que ses regards, que ses gestes pour s’opposer aux Waterford. Ils peuvent briser son corps, ils ne peuvent taire cette voix.
Enfin, même si l’adaptation est très fidèle au livre, les scénaristes ont dû ouvrir des pistes pour proposer plusieurs saisons et alimenter l’intrigue. Même si on peut regretter le côté un peu artificiel des épisodes sur l’extérieur de Gilead, au Canada par exemple, la série offre un vrai regard sur le couple Waterford, le couple des maîtres, la relation entre le mari et sa femme. Eux aussi sont traversés de contradictions, d’hésitations, de failles, conscients, au fur et à mesure des épisodes que leur paradis rêvé ne les comble pas tout à fait.
L’adaptation réussit surtout à rendre toute la richesse du propos du livre, sans le dénaturer, en créant une atmosphère visuelle tout à fait identifiable et qui sert ce propos plutôt que de se contenter de répéter un message politique. On souffre d’abord pour Defred, puis on découvre le contexte, les origines de cette dérive.
Sa médiatisation avait été bien moindre que celle de la série de Hulu mais en 1990, le réalisateur allemand Volker Schlöndorff avait déjà porté à l’écran le roman d’Atwood avec Natasha Richardson dans le rôle de Defred (baptisée ici Kate) et Faye Dunaway dans celui de Serena. Le film offre une adaptation forcément plus ramassée que la série mais tout aussi terrifiante. Certains rôles manquent parfois d’épaisseur, en particulier celui du Commandant et de sa femme, tenus par des acteurs nettement plus âgés que dans la série et moins ambivalents, plus caricaturaux. La révolte de l’héroïne est plus nuancée, plus discrète (même si à l’instar du roman, jamais elle ne se laisse oublier), les costumes moins spectaculaires. Cela n’en reste pas moins une très belle adaptation qui gagnerait à être plus connue.

Pour aller plus loin :
Fantasy, Fantastique, SF… mais pourquoi la France a-t-elle un problème avec l’imaginaire ?
Livres de science-fiction: «La France est en train de rater un rendez-vous majeur avec le public»









Partager cet article